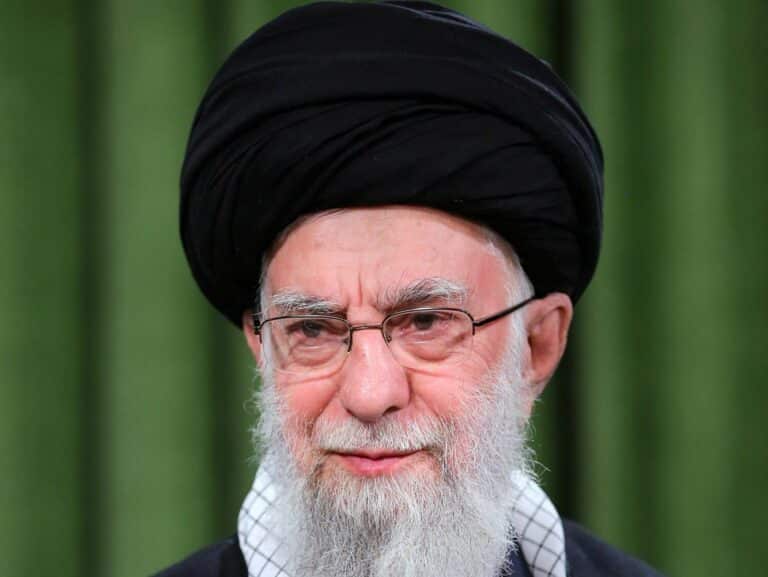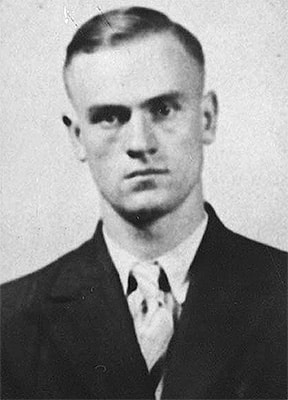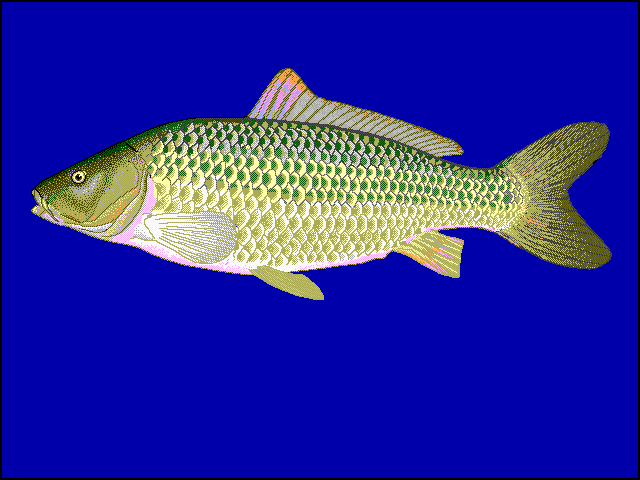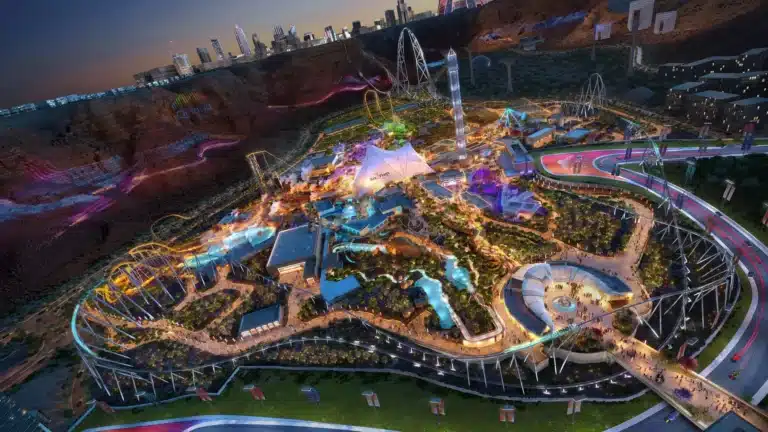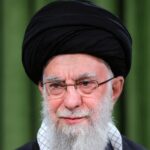En 1973, en pleine crise pétrolière et au début des débats sérieux sur l’avenir énergétique de l’humanité, un scientifique et ingénieur américain d’origine tchèque, Peter Glaser, a eu une idée si audacieuse qu’elle relevait de la science-fiction. Il a imaginé d’énormes centrales solaires en orbite géostationnaire, qui capteraient l’énergie solaire 24 heures sur 24 et la transmettraient sans fil à la Terre sous forme de micro-ondes. Son brevet, bien que visionnaire à l’époque, s’est heurté à des limites technologiques et économiques. Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, avec les technologies avancées, les fusées réutilisables et l’urgence de la crise climatique, la question revient avec une nouvelle acuité : le rêve de Glaser est-il enfin réalisable avec les outils d’aujourd’hui ?
La réponse n’est pas simple. Bien que le principe de base reste le même et physiquement valide, le chemin vers sa réalisation est encore semé d’énormes défis. Néanmoins, il semble que nous soyons plus proches de son accomplissement que jamais.
Pourquoi l’espace ? La raison est toujours valable
La prémisse de base de Glaser était et reste géniale. Les centrales solaires terrestres ont deux problèmes majeurs : l’alternance du jour et de la nuit et l’influence des conditions météorologiques (nébulosité). Une centrale électrique en orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres d’altitude s’affranchirait de ces limitations. Elle serait exposée à la lumière du soleil plus de 99 % du temps, et ce, à son intensité maximale et non filtrée. Le gain énergétique théorique serait bien supérieur à celui des panneaux terrestres de même taille. Cet argument est encore plus pertinent aujourd’hui, alors que nous recherchons des sources d’énergie stables et sans émissions pour remplacer les combustibles fossiles.
Ce qui a changé : un bond technologique en avant
Lorsque Glaser a breveté son concept, il s’appuyait sur des technologies qui étaient soit à leurs balbutiements, soit n’existaient que sur le papier. Aujourd’hui, la situation est radicalement différente.
- L’efficacité des panneaux solaires : Glaser prévoyait une efficacité de 15 à 20 %. Les panneaux solaires spatiaux les plus modernes d’aujourd’hui, bien qu’extrêmement chers, dépassent déjà cette limite et atteignent une efficacité de plus de 30 %, voire plus en laboratoire. Le développement de matériaux plus légers, plus flexibles et plus durables permet en outre de construire d’énormes voiles solaires relativement légères.
- La transmission d’énergie : La conversion de l’électricité en micro-ondes et sa reconversion sont aujourd’hui technologiquement maîtrisées. L’efficacité de ce processus est cruciale, et les systèmes modernes atteignent une grande performance. Les craintes de „faire cuire“ tout ce qui traverserait le faisceau sont infondées. La densité énergétique du faisceau serait faible et sûre, répartie sur une grande antenne de réception (appelée rectenne) sur Terre, qui s’étendrait sur plusieurs kilomètres carrés.
- Le transport spatial – la révolution SpaceX : Le plus grand obstacle a toujours été le coût du transport des matériaux en orbite. À l’époque des navettes spatiales, un kilogram de charge utile coûtait des dizaines de milliers de dollars. Cela a radicalement changé avec l’arrivée de sociétés privées comme SpaceX et leurs fusées réutilisables Falcon 9, et surtout le futur lanceur Starship. Elon Musk promet de réduire les coûts à des centaines, voire des dizaines de dollars par kilogramme. C’est un changement qui fait passer l’ensemble du concept des centrales spatiales du domaine du rêve à celui des projets économiquement calculables.
Les défis qui persistent : un cauchemar d’ingénierie
Malgré les progrès technologiques, d’énormes défis restent à relever.
- L’échelle et la construction : Une centrale spatiale capable d’alimenter une grande ville devrait mesurer plusieurs kilomètres carrés. Assembler une structure aussi gigantesque et fragile en orbite à l’aide de robots serait une prouesse d’ingénierie et de logistique comparable au programme Apollo.
- Les débris spatiaux et la maintenance : La structure serait constamment menacée par les micrométéoroïdes et la quantité croissante de débris spatiaux. Sa maintenance et ses réparations à 36 000 km d’altitude seraient extrêmement complexes et coûteuses.
- L’économie et la rentabilité : Même avec une réduction spectaculaire des coûts de transport, il s’agirait toujours du projet énergétique le plus cher de l’histoire de l’humanité, avec un investissement initial de l’ordre de centaines de milliards, voire de billions de dollars. La question de la rentabilité serait politiquement et économiquement très sensible.
- La géopolitique : Qui posséderait et contrôlerait une telle centrale ? Pourrait-elle être utilisée comme une arme (même en coupant simplement l’approvisionnement en énergie) ? Son existence ouvrirait un nouveau chapitre des relations internationales et du droit spatial.
Du rêve aux prototypes
Le rêve de Glaser est-il donc réalisable ? Une centrale massive et à part entière alimentant la Terre reste une musique d’avenir lointain. Cependant, nous sommes dans une phase où l’idée passe des spéculations théoriques à des expériences concrètes. Des agences spatiales comme la NASA, la JAXA (Japon), et plus récemment la Chine et le Royaume-Uni, ont des programmes actifs qui étudient des aspects de cette technologie. En 2023, par exemple, le Caltech a testé avec succès un prototype en orbite capable de collecter et de transmettre sans fil de petites quantités d’énergie.
La vision de Glaser n’est plus de la simple science-fiction. Elle est devenue une source d’inspiration pour une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques. Avec la technologie d’aujourd’hui, nous sommes capables de construire et de tester de plus petits démonstrateurs et de valider les technologies clés. Le chemin vers l’utilisation complète de l’énergie solaire depuis l’espace sera encore long et coûteux, mais les portes que Peter Glaser a entrouvertes en 1973 sont aujourd’hui plus grandes que jamais. Son rêve devient lentement mais sûrement un objectif technologique réaliste.