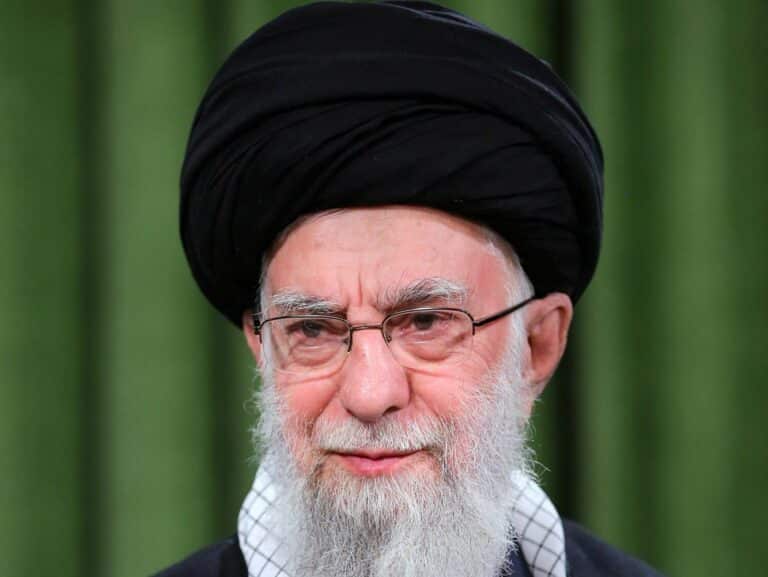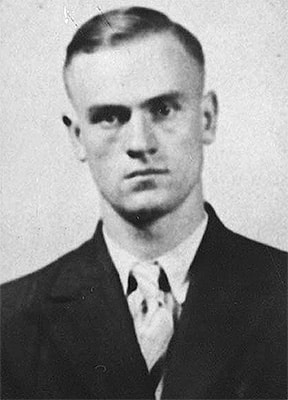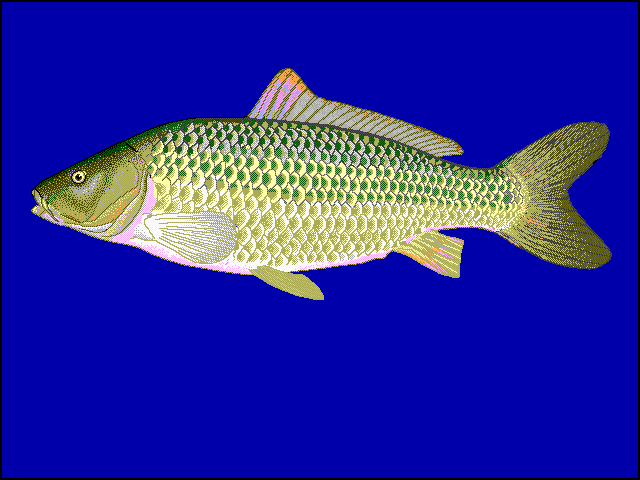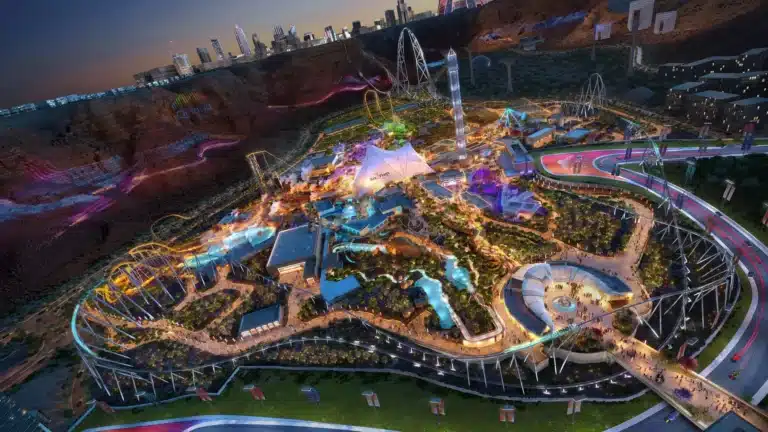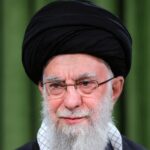SCHWYZ/ALTDORF – À la fin du XIIIe siècle, l’Europe centrale est un échiquier politique complexe dominé par le Saint-Empire romain germanique. Au cœur des Alpes, trois petites communautés paysannes, connues sous le nom de Waldstätten (les « cantons forestiers »), jouissent d’une relative autonomie. Grâce à leur contrôle stratégique du col du Gothard, une route commerciale vitale reliant l’Allemagne à l’Italie, elles ont obtenu de l’empereur le statut d’« immédiateté impériale », ce qui signifie qu’elles ne dépendent d’aucun seigneur local, mais directement de l’empereur lui-même.
Cependant, cette liberté est fragile. La puissante dynastie des Habsbourg, qui cherche à étendre son influence dans la région, représente une menace constante. La mort de l’empereur Rodolphe Ier de Habsbourg en juillet 1291 crée un vide de pouvoir et fait naître la crainte que ses successeurs ne cherchent à révoquer les privilèges des cantons et à les soumettre à leur autorité directe par l’intermédiaire de leurs baillis (des administrateurs locaux souvent perçus comme tyranniques).
C’est dans ce climat d’incertitude que les élites locales d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald décident d’agir. Plutôt que de subir leur sort, elles choisissent de le forger. Au début du mois d’août 1291, elles signent un document qui entrera dans l’Histoire : le Pacte Fédéral. Rédigé en latin sur un parchemin de peau de mouton, ce texte n’est pas une déclaration d’indépendance. Il s’agit avant tout d’une alliance défensive et d’un traité de paix intérieure.
Ses clauses sont claires et pragmatiques. Les signataires s’engagent à s’aider et à se conseiller mutuellement, par tous les moyens, contre quiconque leur infligerait violence ou injustice. Ils refusent d’accepter tout juge étranger ou qui aurait acheté sa charge, insistant pour que la justice soit rendue par des hommes issus de leurs propres communautés. Le pacte établit également des règles pour arbitrer les conflits internes, garantissant ainsi la cohésion de l’alliance. C’est un engagement de solidarité face à une menace extérieure commune.
Cette histoire factuelle est magnifiée par une légende puissante qui a façonné l’identité nationale suisse : le mythe de Guillaume Tell et le Serment du Grütli. Selon ce récit, popularisé bien plus tard, des représentants des trois cantons se seraient réunis secrètement dans la prairie du Grütli pour prêter serment de libérer leur patrie. Le personnage de Guillaume Tell, l’arbalétrier forcé par le bailli Gessler à tirer sur une pomme posée sur la tête de son fils, incarne l’esprit de résistance contre l’oppression. Bien que les historiens considèrent aujourd’hui cette légende comme un mythe fondateur plutôt qu’un fait historique, son impact culturel est immense.
La véritable force du Pacte de 1291 se révélera quelques décennies plus tard. En 1315, à la bataille de Morgarten, une petite armée de paysans confédérés inflige une défaite humiliante à la puissante cavalerie des Habsbourg. Cette victoire inattendue prouve que leur alliance n’est pas un vain mot. Elle consolide leur union et attire d’autres communautés qui cherchent à préserver leur liberté. Au cours des décennies suivantes, des villes comme Lucerne, Zurich et Berne rejoignent la coalition, formant progressivement le noyau de la Confédération des VIII cantons.
Aujourd’hui, le 1er août est la fête nationale suisse, célébrée en commémoration de ce pacte fondateur. Bien que la Suisse moderne, avec ses 26 cantons et sa neutralité affirmée, soit le résultat d’une longue et complexe évolution, les principes inscrits dans le document de 1291 résonnent encore : la souveraineté locale, la solidarité face à l’adversité et la volonté de régler ses propres affaires. D’un simple acte de précaution signé à l’ombre des Alpes est née une nation dont la stabilité et l’indépendance sont devenues légendaires.