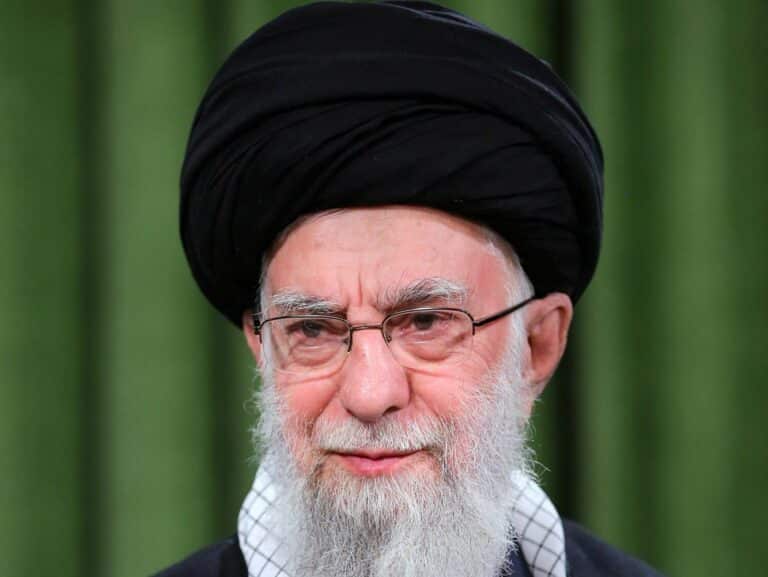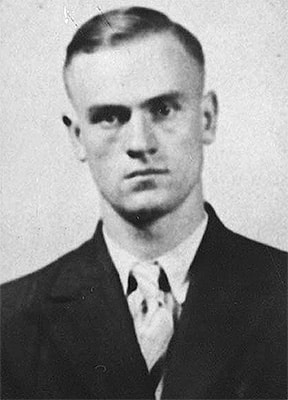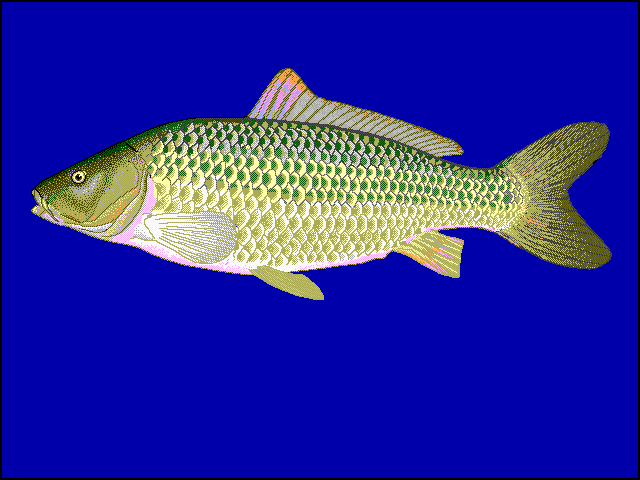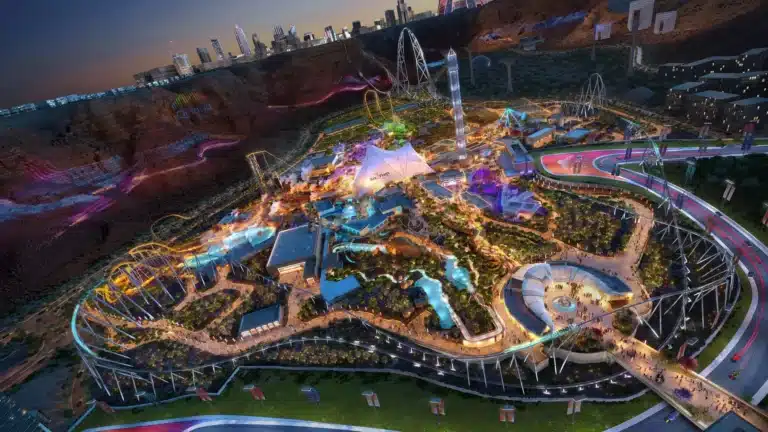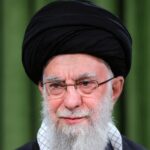TOULOUSE/PARIS – Au milieu des années 1960, le ciel du monde était presque exclusivement américain. Les avions à réaction géants comme le Boeing 707, le Douglas DC-8, et plus tard le Boeing 747, dominaient les liaisons long-courriers et définissaient le transport aérien moderne. L’industrie aéronautique européenne, autrefois un fier pionnier, était fragmentée, technologiquement à la traîne et incapable de rivaliser avec la force et le capital des géants américains. C’est de cette frustration et de ce sentiment de menace qu’est né l’un des projets industriels les plus ambitieux de l’histoire européenne : Airbus.
L’histoire d’Airbus n’est pas seulement celle de l’ingénierie ; c’est avant tout celle d’une volonté politique, d’une coopération internationale et d’un pari audacieux contre l’ordre établi. Sans lui, l’industrie aéronautique d’aujourd’hui serait complètement différente.
Contexte : la domination américaine et l’impuissance européenne
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus le leader incontesté de l’aviation civile. Des entreprises comme Boeing, McDonnell Douglas et Lockheed disposaient d’un immense marché intérieur, d’un soutien massif des contrats militaires et du capital nécessaire pour développer des avions toujours plus grands et plus efficaces.
Pendant ce temps, l’Europe luttait contre les conséquences de la guerre. Bien que des pays individuels comme le Royaume-Uni (avec les avions Comet et Trident) ou la France (avec l’élégant Caravelle) aient réussi à développer des avions innovants, leur succès était limité. Aucune entreprise européenne seule n’avait les ressources ou la force de marché pour développer un avion de grande capacité capable de concurrencer Boeing. Les compagnies aériennes européennes, y compris les compagnies nationales, étaient contraintes d’acheter des avions américains, ce qui affaiblissait encore plus l’industrie nationale.
La genèse de l’idée : la coopération comme seule voie
Au début des années 1960, les politiciens et les industriels en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ont réalisé que s’ils ne coopéraient pas, leur industrie aéronautique finirait par disparaître. L’idée d’un projet européen commun n’était pas nouvelle – des tentatives infructueuses avaient déjà eu lieu. Mais cette fois, la situation était critique.
En 1967, les ministres français, allemand et britannique ont signé un protocole d’accord qui a jeté les bases du développement d’un avion de grande capacité pour les liaisons courtes et moyennes. L’objectif était de créer un avion plus économique que la concurrence américaine et parfaitement adapté aux besoins du réseau aérien européen dense. Le projet a reçu le nom de travail A300, en référence à une capacité d’environ 300 passagers.
La naissance d’un consortium et le premier avion, l’A300
La naissance officielle d‘Airbus Industrie remonte au 18 décembre 1970. C’était un consortium, pas une entreprise traditionnelle. Les membres fondateurs étaient le français Aérospatiale et l’allemand Deutsche Airbus (un regroupement de plusieurs entreprises). L’espagnol CASA a rejoint le groupe en 1971. Le Royaume-Uni s’était temporairement retiré du projet en 1969 pour des raisons financières, mais son entreprise Hawker Siddeley a continué à développer et à produire les ailes en tant que sous-traitant. Plus tard, la Grande-Bretagne est revenue dans le consortium en tant que membre à part entière.
Le cœur du projet était l’A300. Les ingénieurs d’Airbus ont eu un concept révolutionnaire : ce fut le premier avion gros-porteur au monde propulsé par seulement deux moteurs. À l’époque, c’était un pari extrêmement audacieux. Les gros-porteurs concurrents (Boeing 747, DC-10, L-1011) avaient trois ou quatre moteurs. Deux moteurs signifiaient une consommation de carburant et des coûts d’exploitation nettement inférieurs, ce qui était précisément l’avantage dont Airbus avait besoin.
Un casse-tête industriel et un miracle logistique
L’un des plus grands problèmes était la production elle-même. Chaque pays voulait conserver sa part du travail et de son savoir-faire. Le résultat a été un modèle de production unique et décentralisé, qu’Airbus utilise encore aujourd’hui :
- France (Toulouse) : Cockpit, partie centrale du fuselage et assemblage final.
- Allemagne (Hambourg, Brême) : Parties avant et arrière du fuselage, équipements intérieurs.
- Royaume-Uni (Filton, Broughton) : Ailes.
- Espagne (Madrid) : Empennages horizontaux.
- Pays-Bas : Pièces mobiles des ailes.
Mais comment transporter ces énormes pièces en un seul endroit pour l’assemblage final à Toulouse ? La solution fut une flotte d’avions de transport modifiés, les Aero Spacelines Super Guppy – des avions d’apparence bizarre avec un énorme fuselage amovible, capables d’accueillir des sections entières de fuselage ou des ailes. Ce système logistique est devenu un symbole de la coopération européenne.
Des débuts difficiles et la percée finale
Le premier prototype de l’A300 a volé en 1972 et est entré en service en 1974 avec Air France. Cependant, les ventes initiales furent désastreuses. Le monde était en pleine crise pétrolière et les compagnies aériennes étaient prudentes. L’avion était technologiquement avancé, mais personne n’en voulait. À un moment donné, 16 „queues blanches“ (avions sans les couleurs des compagnies) non vendues étaient stationnées à Toulouse.
La percée est venue d’une direction inattendue : des États-Unis. En 1977, Frank Borman, ancien astronaute et à l’époque PDG de la compagnie aérienne américaine Eastern Air Lines, a été convaincu de louer gratuitement les avions A300 pour un essai. Les avions se sont révélés extraordinairement fiables en service et 30 % plus économes en carburant que la flotte d’avions trimoteurs américains. Borman était enchanté et a commandé 23 appareils.
Cette commande a brisé la glace. Si Airbus était assez bon pour une grande compagnie américaine, il était assez bon pour tout le monde. Les commandes ont commencé à affluer et le projet a été sauvé. Le succès de l’A300 a été suivi par l’A310 plus court et surtout par la légendaire famille d’avions à fuselage étroit A320, qui, dans les années 1980, a catapulté Airbus au même niveau que Boeing.
La création d’Airbus a prouvé que la coopération européenne peut réussir même dans les secteurs technologiques les plus exigeants. Né de la nécessité, il a été poussé par une vision politique et sauvé par l’audace de l’ingénierie. Il a créé un duopole qui définit encore aujourd’hui l’industrie aéronautique mondiale et assure une saine concurrence dont les passagers du monde entier bénéficient.