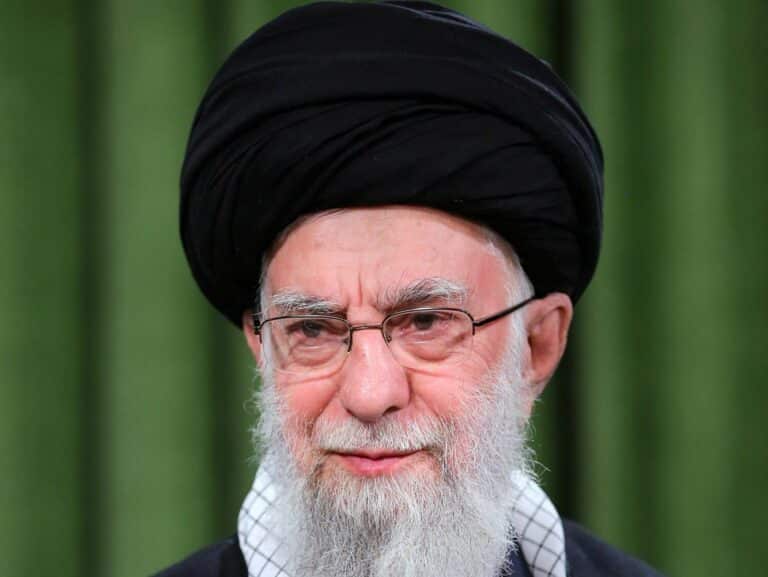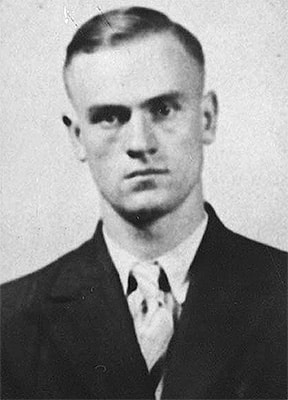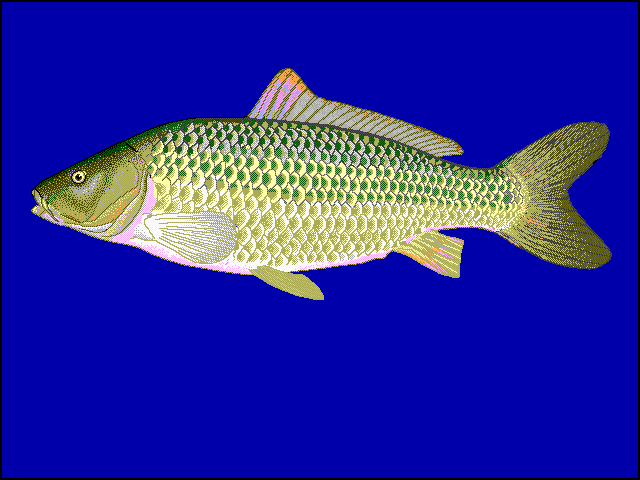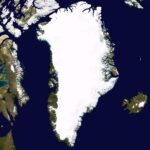L’empreinte écologique réelle des voitures électriques : une étude de l’université tchèque de technologie (CTU) remet en question les idées reçues
Le débat passionné sur l’avenir des transports se résume souvent à une équation simple : les moteurs à combustion sont le mal, les véhicules électriques sont le salut. Cependant, dans leur étude détaillée, les experts du Centre des véhicules pour une mobilité durable de l’Université technique tchèque (CTU) de Prague, Jan Macek et Josef Morkus, proposent une vision plus mesurée. Leur analyse montre que les attentes exagérées concernant le déploiement massif des véhicules à batterie sont fondées sur des données déformées et ignorent des facteurs clés. Selon eux, la véritable empreinte écologique des véhicules électriques est bien plus complexe et, dans de nombreux cas, nettement supérieure à ce qui est couramment admis.
L’objectif de l’étude n’est pas de remettre en question les avantages de l’électromobilité, par exemple en milieu urbain, mais de corriger le récit universel de leur supériorité écologique inconditionnelle. Les auteurs ont identifié trois omissions cruciales dans les études fréquemment citées qui conduisent à des conclusions trop optimistes.
1. La dette cachée de la batterie : des émissions dont on ne parle pas
La plus grande différence entre un véhicule électrique et un véhicule à moteur à combustion est la batterie de traction. Sa production est extrêmement gourmande en énergie et représente une énorme „dette d’émissions“ que le véhicule électrique doit d’abord „rembourser“ pendant son fonctionnement avant de pouvoir devenir plus écologique.
Les analyses se concentrent souvent uniquement sur la consommation d’électricité lors de la fabrication des batteries. L’étude du CTU souligne cependant qu’un coupable encore plus grand est oublié : la chaleur technologique. Les processus métallurgiques et chimiques pour l’extraction et le traitement de matériaux comme le lithium, le nickel, le cobalt ou l’aluminium nécessitent une quantité colossale de chaleur, qui est aujourd’hui principalement produite par la combustion de gaz naturel ou de charbon. Les émissions issues de cette chaleur peuvent être comparables, voire supérieures, aux émissions de l’électricité consommée.
Un autre facteur critique est la géographie. Environ 80 % des matériaux et des cellules de batterie sont aujourd’hui fabriqués en Chine, dont le mix énergétique dépend encore en grande partie du charbon. Le facteur d’émissions de l’électricité chinoise est donc plusieurs fois supérieur à la moyenne européenne. Alors que les estimations optimistes tablent sur des émissions d’environ 50 kg de CO₂ par kWh de capacité de batterie, les chiffres plus réalistes pour une production en Pologne (où se trouve l’usine LG) ou en Chine se situent autour de 150 kg de CO₂ par kWh, et peuvent même atteindre 300 kg de CO₂ par kWh dans certains cas.
Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Une batterie d’une capacité de 64 kWh, comme celle du modèle Hyundai Kona testé, transporte une dette d’émissions de près de 10 tonnes de CO₂ depuis l’usine. C’est plus que ce que produit l’ensemble d’une voiture conventionnelle pendant sa fabrication (environ 7 à 8 tonnes de CO₂).
2. Consommation théorique vs. réalité sur la route
La deuxième distorsion majeure est la dépendance aux cycles de test officiels, tels que le WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Cycle). Ce cycle a été initialement conçu pour mesurer les polluants des moteurs à combustion et fonctionne de manière assez fiable pour estimer leur consommation. Mais il échoue pour les véhicules électriques.
La raison en est la surévaluation du rôle de la récupération d’énergie. Dans les courtes phases du test qui simulent la conduite hors de la ville, il y a souvent du freinage et des ralentissements, ce qui permet au véhicule électrique de recharger efficacement la batterie. Cependant, en utilisation réelle sur de longues distances, par exemple lors d’un trajet continu sur autoroute, la récupération est minimale.
Une autre différence apparaît en hiver. Alors que le moteur à combustion se chauffe avec la chaleur perdue, le véhicule électrique doit se chauffer avec l’énergie de la batterie, ce qui augmente considérablement la consommation. L’étude GreenNCAP et les propres mesures des auteurs montrent que la consommation réelle moyenne des véhicules électriques est de 30 à 50 % supérieure aux valeurs déclarées du WLTC. Par exemple, pour la Hyundai Kona testée, la consommation réelle était même supérieure de 48 %. Pour les véhicules à moteur à combustion, de telles différences n’existent pas ; leur consommation réelle est souvent même légèrement inférieure à la valeur „officielle“.
3. Le point de basculement : quand le véhicule électrique devient-il vraiment rentable ?
La combinaison de la dette d’émissions élevée due à la fabrication de la batterie et de la consommation d’énergie réelle plus élevée décale considérablement le point de rupture – c’est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus après lequel le véhicule électrique devient plus avantageux en termes d’émissions totales de CO₂ qu’une voiture à moteur à combustion comparable.
Les auteurs de l’étude ont recalculé la comparaison pour différentes versions de la Hyundai Kona en utilisant des données réalistes. Les résultats sont frappants :
- Avec le mix d’émissions d’électricité moyen en Europe (attendu pour 2028), la Kona électrique avec une batterie de 64 kWh est, après avoir parcouru 150 000 km, comparable en termes d’émissions à la version hybride et seulement 11 % meilleure qu’un diesel moderne.
- Dans un pays avec de l’électricité „sale“ comme la Pologne (où le facteur d’émissions est plus du double de la moyenne de l’UE), la situation est encore pire. Après 150 000 km, les deux véhicules électriques testés ont des émissions 30 % et 45 % plus élevées que la version diesel, respectivement. Ils ne deviendront pratiquement jamais plus écologiques.
- Inversement, dans un pays avec de l’électricité à faible teneur en carbone, comme la Slovaquie (grâce à l’énergie nucléaire), le véhicule électrique devient avantageux beaucoup plus tôt.
L’étude montre clairement qu’il n’y a pas de réponse universelle. La rentabilité d’un véhicule électrique dépendra de manière drastique du lieu où sa batterie a été fabriquée et de son lieu de conduite.
La durée de vie de la batterie : le temps est un plus grand ennemi que les kilomètres
Un argument fréquent est que la batterie survivra à la durée de vie du véhicule. Cependant, les auteurs de l’étude attirent l’attention sur un facteur clé, mais souvent négligé : la dégradation temporelle. La capacité de la batterie ne diminue pas seulement avec le nombre de cycles de charge, mais aussi avec le temps, que la voiture roule ou non.
Pour de nombreux foyers, un véhicule électrique est la deuxième voiture de la famille avec un kilométrage annuel plus faible (par exemple, 10 000 km). Dans ce cas, il est très probable que la batterie atteigne la fin de sa durée de vie (généralement 8 à 10 ans) avant d’avoir parcouru suffisamment de kilomètres pour rembourser sa dette d’émissions. De plus, le remplacement de la batterie sur une voiture plus ancienne n’est pas économiquement viable, ce qui raccourcit la durée de vie de l’ensemble du véhicule.
Quelles sont les pistes à suivre ?
L’étude ne se contente pas de critiquer, mais propose aussi des solutions rationnelles :
- Des batteries plus petites : La tendance à produire des véhicules électriques avec d’énormes batteries et une autonomie de plus de 500 km est contre-productive d’un point de vue écologique. La dette d’émissions est trop importante. Les véhicules électriques urbains avec des batteries plus petites (environ 35 kWh) ont plus de sens, car la faible autonomie n’y est pas un problème.
- De l’électricité propre : Le véritable avantage des véhicules électriques ne se matérialisera qu’avec la transition vers des sources d’électricité stables et à faible teneur en carbone. Les auteurs soulignent que la solution n’est pas les sources renouvelables instables, qui doivent être complétées par des combustibles fossiles, mais l’énergie nucléaire, comme le montre l’exemple de la France avec un facteur d’émissions dix fois inférieur à celui de l’Allemagne.
- Neutralité technologique : Pousser une seule „bonne“ solution est, selon les auteurs, une erreur. Il est nécessaire de laisser le choix aux utilisateurs et de soutenir diverses solutions – des moteurs à combustion modernes et économes aux hybrides, en passant par les véhicules électriques là où ils ont du sens.
Conclusion : Le besoin d’honnêteté et de réalisme
L’étude du CTU est une voix importante dans un débat émotionnel. Elle rappelle que la mobilité zéro émission n’existe pas et que chaque technologie a un coût environnemental. La promotion massive et dépendante des subventions des véhicules électriques sans tenir compte de l’ensemble de leur cycle de vie – de l’extraction des matières premières en Chine à la production d’électricité en Pologne – n’apportera pas les bénéfices climatiques attendus. Le chemin vers un transport durable ne passe pas par des décrets idéologiques, mais par une analyse honnête des données, la diversité technologique et une évaluation réaliste de tous les impacts.