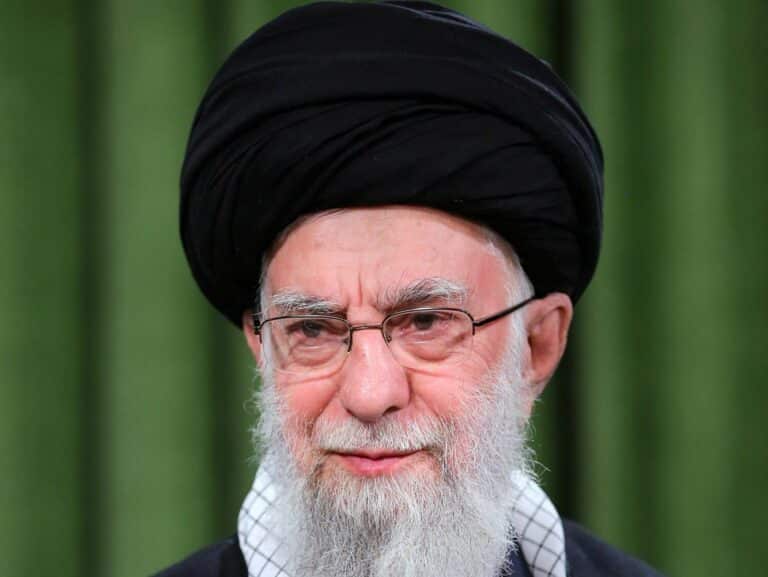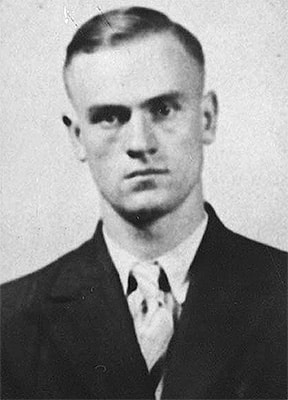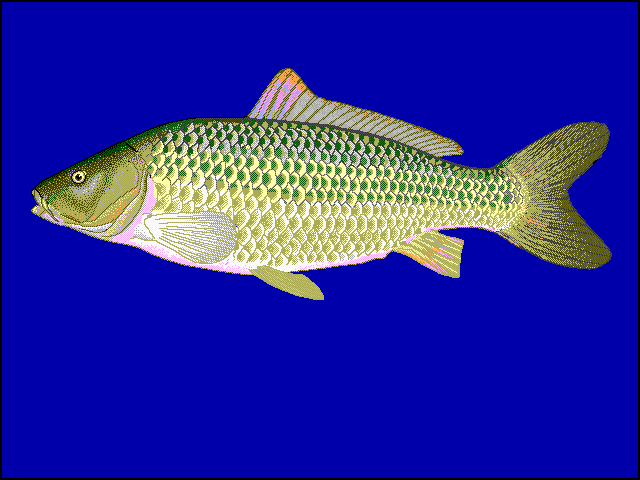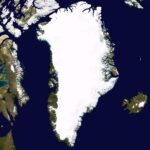À Bruxelles et dans d’autres métropoles européennes, des voix s’élèvent pour réclamer une électrification rapide et complète du transport de passagers et de marchandises. Les objectifs sont nobles : réduire les émissions, lutter contre le changement climatique et favoriser le progrès technologique. Les projets d’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur à combustion après 2035 en sont la preuve évidente. Cependant, dans la course effrénée vers la neutralité climatique, un aspect essentiel semble avoir été négligé, ou du moins sous-estimé : les risques sécuritaires et stratégiques liés à la dépendance totale à l’énergie électrique dans les transports, en particulier dans le contexte d’un éventuel conflit militaire avec la Russie.
La guerre en Ukraine nous a donné une leçon dure et concrète sur ce à quoi ressemblent les conflits modernes. L’un des objectifs clés de l’agression russe était l’infrastructure énergétique ukrainienne : centrales électriques, sous-stations, postes de transformation. Il en a résulté des pannes de courant à grande échelle qui ont paralysé non seulement la vie quotidienne des civils, mais aussi le fonctionnement des infrastructures critiques, de l’industrie et de la logistique. Imaginons maintenant un scénario dans lequel l’Union européenne serait confrontée à une attaque similaire et où son parc automobile serait composé en grande majorité de véhicules électriques.
Le talon d’Achille de l’électromobilité : la dépendance au réseau
Les voitures électriques, bien que technologiquement avancées, ont une caractéristique fondamentale : elles ont besoin d’être rechargées régulièrement à partir du réseau électrique pour fonctionner. Ce réseau, aussi robuste soit-il en temps de paix, est une cible extrêmement vulnérable en cas de conflit militaire. Il suffirait de quelques frappes bien ciblées sur des centrales électriques clés, des postes de transformation principaux ou des lignes électriques principales pour que de vastes régions se retrouvent sans électricité pendant des jours, des semaines, voire des mois.
Dans un tel scénario, des millions de voitures électriques deviendraient de simples morceaux de métal immobiles. Sans possibilité de recharge, non seulement le transport personnel des citoyens serait paralysé, mais aussi des éléments clés de l’État et de l’économie :
- Logistique et approvisionnement : les camions électriques ne pourraient plus transporter de denrées alimentaires, de médicaments, de carburant (pour les moteurs à combustion ou les générateurs restants) et d’autres produits de première nécessité.
- Services de secours : les ambulances, les camions de pompiers ou les véhicules de police, s’ils étaient électriques, auraient une autonomie et une capacité d’action limitées.
- Mobilité militaire : bien que les armées utilisent encore principalement des technologies conventionnelles, la pression en faveur d’une « écologisation » pourrait également les toucher à l’avenir. La dépendance à l’égard de la recharge serait une limitation fatale dans des conditions de combat.
- Évacuation de la population : l’impossibilité d’utiliser des voitures particulières compliquerait considérablement l’évacuation des civils des zones menacées.
La Russie, en tant que pays doté de capacités développées dans le domaine des cyberattaques et de la destruction conventionnelle des infrastructures, serait sans aucun doute consciente de cette vulnérabilité. La paralysie stratégique de la mobilité électrique européenne pourrait devenir l’un des principaux objectifs d’une éventuelle agression.
Le moteur à combustion interne comme réserve stratégique (involontaire) ?
En revanche, les véhicules à moteur à combustion interne, bien qu’ils soient confrontés à leurs propres défis logistiques (approvisionnement en carburant), offrent un certain degré de décentralisation et de résilience dans les scénarios de crise. Le carburant peut être stocké à différents endroits et distribué par camions-citernes, même dans des conditions improvisées. La mise hors service de toutes les stations-service et de tous les réservoirs de carburant est une tâche beaucoup plus complexe que la mise hors service de quelques points clés du réseau électrique.
Bien sûr, les réserves de combustibles fossiles sont également vulnérables, mais leur nature permet une plus grande flexibilité et la possibilité de créer des réserves stratégiques dispersées sur le territoire. En cas de panne du réseau électrique, les véhicules à moteur à combustion resteraient le seul moyen de transport individuel et collectif fiable.
Eurofighter Typhoon: Páteř evropské obrany s vizí budoucnosti navzdory svému věku
Il est nécessaire de réévaluer l’électrification aveugle
Cet article n’a pas pour but de nier les avantages environnementaux de l’électromobilité en temps de paix. Son objectif est toutefois de mettre en garde contre une transition unilatérale et forcée vers un seul type de motorisation, qui comporte des risques sécuritaires aussi importants, en particulier dans la situation géopolitique actuelle.
L’Union européenne devrait réévaluer son approche de l’électrification des transports et prendre en considération les éléments suivants :
- Préserver la diversité des modes de propulsion : maintenir en service et soutenir d’autres technologies, notamment les moteurs à combustion modernes et efficaces, les systèmes hybrides ou les véhicules fonctionnant avec des carburants synthétiques, comme solution de secours stratégique.
- Renforcer la résilience du réseau énergétique : investir massivement dans la protection et la décentralisation des infrastructures énergétiques, y compris les ressources locales et les micro-réseaux.
- Élaboration de plans stratégiques pour la mobilité en cas de crise : élaborer des scénarios en cas de pannes de courant à grande échelle et garantir des modes de transport et d’approvisionnement alternatifs.
- Évaluation réaliste des risques : discuter ouvertement des implications de la transition verte en matière de sécurité et ne pas fermer les yeux sur les questions délicates.
Il est donc surprenant de constater avec quelle confiance aveugle certains gouvernements, dont celui de la République tchèque, écoutent les voix d’organisations dont l’agenda est manifestement très ciblé. On peut citer l’exemple de l’Union pour l’énergie moderne, une association enregistrée qui se présente comme le défenseur de solutions énergétiques progressistes. À y regarder de plus près, on constate toutefois que ses fondateurs sont exclusivement d’autres associations enregistrées, telles que l’Alliance pour l’autosuffisance énergétique, AKU-BAT CZ, la plateforme technologique tchèque Smart grid, COGEN Czech (association pour la production combinée d’électricité et de chaleur) et l’Association solaire. Chacune de ces entités défend logiquement les intérêts d’un segment spécifique de l’activité économique, qu’il s’agisse de l’énergie solaire, du stockage par batterie, des réseaux intelligents ou de la cogénération. Bien que ces technologies aient leur place dans le mix énergétique, il est légitime de se demander si une association ainsi constituée, dont l’objectif premier est de soutenir les modèles commerciaux spécifiques de ses membres, peut réellement promouvoir une stratégie globale et équilibrée conduisant à une production et une distribution d’électricité sûres, prévisibles et durables à long terme pour l’ensemble du pays.
Avec la Russie à ses portes, qui démontre à plusieurs reprises sa volonté d’utiliser l’énergie comme une arme et de détruire les infrastructures civiles, l’Europe ne peut se permettre d’ignorer une vulnérabilité stratégique aussi fondamentale. Une électrification aveugle et totale des transports, sans plans de secours solides ni diversification, pourrait entraîner à l’avenir non seulement des problèmes économiques, mais aussi un affaiblissement fatal de la capacité de défense et de la résilience de tout le continent. L’heure est venue de faire preuve de pragmatisme et de réflexion stratégique, et non de solutions idéologiques et potentiellement dangereuses. Sinon, l’Europe risque de se retrouver littéralement immobilisée, un câble de recharge à la main, en cas de conflit.