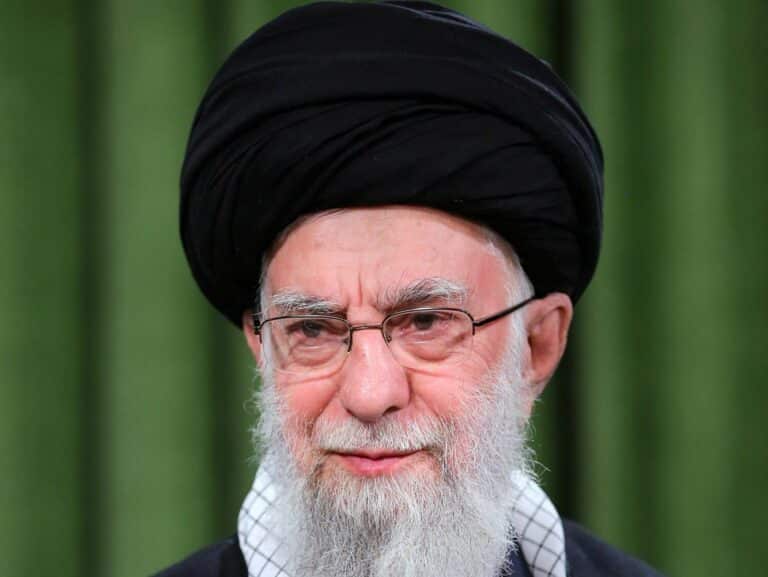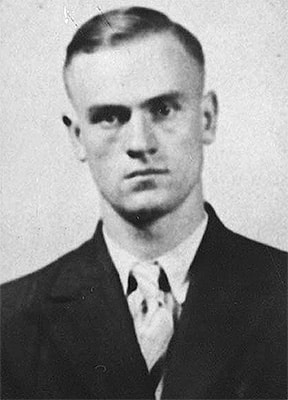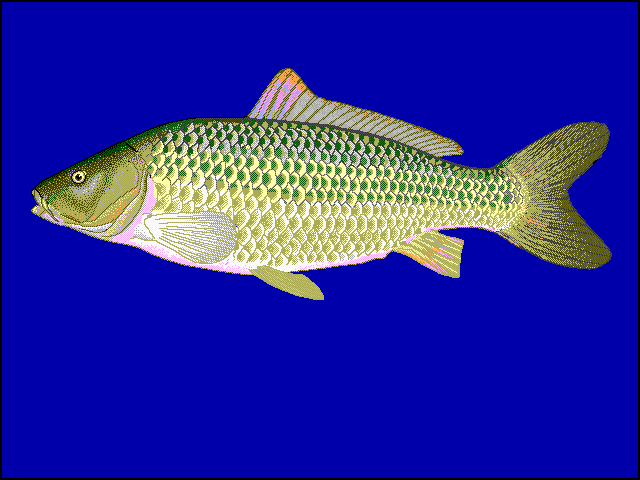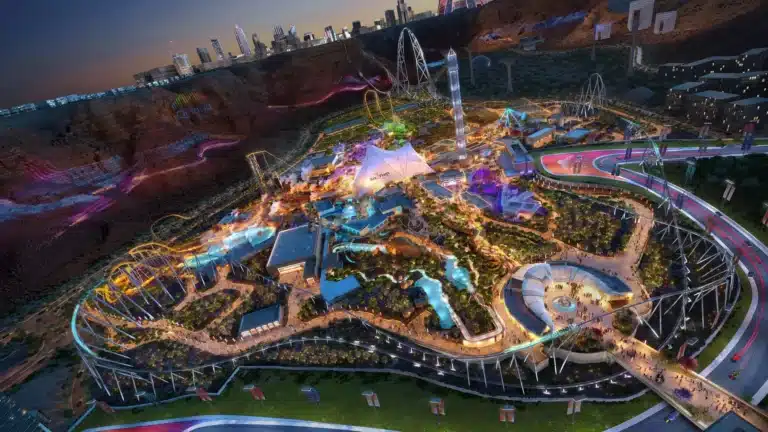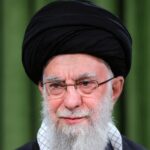L’instabilité politique en France conduit à une réévaluation fondamentale de la stratégie énergétique. Le pays du coq gaulois confirme ses investissements massifs dans l’énergie nucléaire tout en limitant ses plans initialement ambitieux de développement des centrales solaires et éoliennes. Cette approche pragmatique, qui combine une source stable avec des sources renouvelables, peut également servir d’inspiration à la République tchèque.
La politique énergétique française est en proie à un chaos politique depuis quelques mois. En juin, la droite conservatrice a tenté de faire adopter par le Parlement un moratoire temporaire sur les nouveaux projets solaires et éoliens, au motif qu’il était nécessaire de réaliser au préalable une étude indépendante sur le mix énergétique optimal. Les craintes concernant la stabilité du réseau, exacerbées par la récente panne massive en Espagne, jouent un rôle clé dans le débat.
Bien que la majorité de gauche ait finalement rejeté le moratoire, la législation finale pour la période allant jusqu’en 2035 est nettement plus modérée. Le projet initial visant à porter la capacité des centrales éoliennes terrestres à 45 GW a été abandonné. En ce qui concerne les centrales solaires, le Parlement a annulé l’objectif de 50 GW d’ici 2030 et a souligné que les nouveaux panneaux photovoltaïques doivent être installés en priorité sur les bâtiments et les surfaces artificielles, et non sur les terres agricoles précieuses.
Alors que les énergies renouvelables font l’objet d’une réévaluation, la France double la mise sur le nucléaire. La législation confirme la relance du programme nucléaire, y compris le projet de construction de 14 nouveaux réacteurs et la possible remise en service de la centrale de Fessenheim. L’objectif est d’augmenter la puissance installée actuelle de 63 GW de 27 GW supplémentaires d’ici 2050 et d’assurer ainsi la voie vers la neutralité carbone.
Cette mesure a toutefois un coût. Afin que la société publique EdF puisse financer ces projets coûteux, le gouvernement lui a permis de vendre l’électricité à environ 70 euros le MWh après 2026, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 42 euros actuels. Il s’agit néanmoins d’un prix compétitif qui garantit la stabilité de l’approvisionnement. Après des problèmes de maintenance des réacteurs en 2022, la France est redevenue en 2024 le plus grand exportateur net d’électricité de l’UE, battant son record historique.
La position française contraste fortement avec celle de l’Allemagne, qui a fermé ses centrales nucléaires et est désormais confrontée à une dépendance aux conditions météorologiques et à la nécessité de soutenir les énergies renouvelables à l’aide de centrales à gaz et à charbon coûteuses et polluantes. « Nous ne voulons pas d’une telle Europe », avait déclaré Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie, rejetant le pari aveugle sur l’énergie solaire et éolienne. Paris insiste sur le fait que chaque pays doit choisir sa propre voie vers la décarbonisation et préconise que l’énergie nucléaire soit pleinement reconnue comme une source propre.
Le modèle français, qui combine une base nucléaire solide et stable avec un développement prudent des énergies renouvelables, est considéré comme une alternative rationnelle à la « Energiewende » allemande. Pour la République tchèque, qui, après les subventions scandaleuses accordées au boom solaire dans le passé et avec de nouveaux projets de construction de réacteurs nucléaires à Dukovany et Temelín, est confrontée à des décisions similaires, l’expérience française est une leçon précieuse. Elle montre qu’une décarbonisation efficace ne signifie pas nécessairement miser aveuglément sur un seul type de technologie, mais plutôt mettre en place une stratégie réfléchie garantissant la sécurité énergétique, l’accessibilité financière et des émissions réellement faibles.